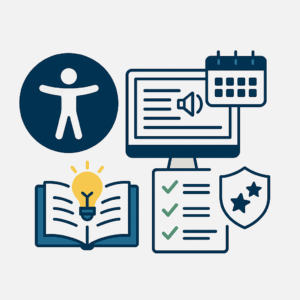J’entends souvent : « il faut maîtriser telle compétence », comme si c’était une case à cocher ou un objectif mesurable à atteindre une fois pour toutes.
Or, dans la réalité des apprentissages, une compétence, ça bouge, ça se construit, ça vit.
C’est pourquoi, dans cet article, je vous propose de prendre un peu de recul.
Nous allons revenir à ce que nous disent les grandes théories de l’apprentissage, afin de mieux comprendre comment une compétence se développe, et surtout, comment l’amener concrètement en classe.
Parce qu’au fond, une compétence, c’est une aventure humaine : un mélange d’action, de réflexion, d’essais, d’erreurs, de doutes et de progression.
Qu’est-ce qu’une compétence ?
Une compétence, c’est bien plus qu’un savoir-faire technique.
C’est la capacité à mobiliser ses savoirs, ses méthodes, ses jugements et ses comportements dans une situation donnée.
Ainsi, quand un étudiant apprend à analyser un cas client, à coder une API ou à conduire un entretien de vente, il ne répète pas un modèle : il expérimente, il tâtonne, il s’approprie.
C’est ce passage du “faire avec aide” au “faire seul” qui marque la véritable montée en compétence.
En d’autres termes, devenir compétent, ce n’est pas accumuler des connaissances,
c’est apprendre à les mobiliser avec discernement.
De la théorie à la salle de classe : un héritage toujours vivant
Derrière notre manière d’enseigner se cachent des racines solides : celles de Piaget, Vygotski et Bruner.
Trois chercheurs, trois époques, trois pays — mais une idée commune :
le savoir ne se transmet pas, il se construit.
- Jean Piaget (1896-1980) voyait l’apprenant comme un explorateur. Il apprend en agissant, en manipulant, en se confrontant au réel.
C’est le constructivisme : l’apprentissage naît de l’expérience. - Lev Vygotski (1896-1934) y ajoute la dimension sociale. On apprend avec les autres, grâce au langage, à la coopération, au dialogue.
Il introduit la Zone Proximale de Développement (ZPD) — cet espace entre ce que l’on peut faire seul et ce qu’on peut réussir avec un appui.Cet accompagnement peut prendre la forme d’explications, de questionnements, de démonstrations ou de rétroactions, apportés par une personne plus compétente (comme l’enseignant). La ZPD illustre donc que l’apprentissage précède souvent le développement : on devient capable d’agir seul après avoir d’abord agi avec de l’aide.
- Jerome Bruner (1915-2016) prolonge cette idée avec la notion d’étayage (scaffolding).
Le formateur soutient, structure, guide… puis se retire progressivement, à mesure que l’autonomie se renforce.
Ainsi, du constructivisme au socio-constructivisme, on passe d’un apprentissage individuel à un apprentissage collaboratif et relationnel.
Et ces principes ne sont pas que théoriques : ils se rejouent chaque jour dans nos classes, chaque fois qu’un enseignant questionne plutôt qu’il n’explique,
ou qu’un étudiant aide un camarade à comprendre.
De la théorie à la compétence : les paliers du développement
Apprendre une compétence, c’est gravir des marches.
Le chercheur Cees van der Vleuten (2002) décrit cette progression en quatre paliers :
- Sait → L’étudiant acquiert les connaissances de base.
Il sait décrire, expliquer, comprendre les concepts clés. - Sait comment faire → Il relie la théorie à la pratique : il raisonne, analyse, teste.
- Fait la démonstration → Il applique ses connaissances dans une situation encadrée : étude de cas, jeu de rôle, projet.
- Fait → Il agit de façon autonome dans un contexte réel : stage, mission, alternance.
Chaque niveau correspond à un degré d’autonomie croissant,
et exige un accompagnement différencié de la part de l’enseignant.
Ainsi, la compétence se construit dans le mouvement, et non dans la simple accumulation.
Les fondations cognitives : du savoir au savoir-agir
Toute compétence naît d’abord dans la tête avant de s’ancrer dans le geste.
Selon John R. Anderson et sa théorie ACT-R, l’apprentissage commence par une connaissance déclarative : savoir quoi faire et pourquoi le faire.
Puis, avec la pratique, ces savoirs deviennent procéduraux : on ne pense plus à chaque étape, on agit.
C’est ce qu’Anderson appelle la procéduralisation :
les étapes se simplifient, se combinent, deviennent naturelles.
Autrement dit, peu à peu, le savoir se transforme en réflexe : on n’a plus besoin d’y penser, le geste suit la pensée sans effort.
De la pratique à la conscience de soi : la régulation métacognitive
Mais pratiquer ne suffit pas.
Encore faut-il réfléchir à sa manière d’apprendre.
C’est la métacognition, introduite par John Flavell : la capacité à observer, analyser et ajuster ses propres stratégies.
De son côté, Barry Zimmerman parle de régulation de soi : planifier, surveiller, évaluer, corriger.
Et David Kolb nous rappelle que la connaissance naît du cycle expérience – réflexion – conceptualisation – réinvestissement.
Ainsi, la pratique seule ne fait pas grandir : c’est la réflexion sur la pratique qui transforme l’expérience en apprentissage durable.
La maîtrise par la structure : décomposer pour mieux reconstruire
Selon Robert Gagné, toute compétence complexe est un assemblage de micro-habiletés.
Observer, classer, relier, interpréter : autant de briques nécessaires avant la performance globale.
C’est en décomposant qu’on apprend à reconstruire.
De plus, David Merrill ajoute que chaque nouvelle compétence s’intègre mieux quand elle est reliée à une situation complète et signifiante.
Autrement dit, on apprend plus vite quand on comprend pourquoi on apprend.
L’action en contexte : là où la compétence prend sens
En effet, une compétence ne vit que dans l’action.
Les travaux de Jean Lave et Étienne Wenger montrent que la connaissance s’enracine dans le contexte social où elle s’exerce.
Apprendre, c’est participer, observer, imiter, puis s’engager à son tour.
Pour Jérôme Bruner, une tâche prend du sens quand elle s’inscrit dans une histoire, un enjeu, une situation réelle.
Et Donald Schön parle du praticien réflexif : celui qui apprend autant dans l’action que sur l’action.
C’est là, au croisement du réel et de la réflexion, que la compétence devient vivante et adaptable.
L’abstraction : le moteur du transfert
Or, pour qu’une compétence soit transférable, il faut pouvoir abstraire :
dégager les principes sous-jacents derrière des situations diverses.
Jean Piaget parlait déjà de cette alternance entre assimilation (intégrer du nouveau dans l’ancien) et accommodation (adapter ses schémas).
Et Dedre Gentner, avec la théorie du mapping structurel, montre que nous comprenons en comparant :
en reliant les situations entre elles pour en extraire les invariants.
C’est cette capacité d’abstraction qui rend la compétence souple, réutilisable et durable.
La consolidation : de la conscience à l’automaticité
La compétence s’installe par étapes, comme l’a décrit Noel Burch :
- Incompétence inconsciente → on ne sait pas qu’on ne sait pas.
- Incompétence consciente → on réalise nos lacunes.
- Compétence consciente → on sait faire, mais avec effort.
- Compétence inconsciente → le geste devient fluide, naturel.
C’est à ce stade que la compétence est intégrée — mais elle n’est jamais figée.
En effet, elle évolue, se réinvente et s’ajuste à de nouveaux contextes.
Apprendre, c’est donc se remettre en mouvement.
Changement de posture en classe
Former par compétences, ce n’est pas transmettre plus de contenu,
c’est accompagner un cheminement.
Cela souligne l’importance de l’évolution du rôle de l’enseignant face à ses étudiants : il devient un guide qui aide à faire sens, plutôt qu’un simple dispensateur de savoirs.
Il ne se tient plus au centre du savoir : il étaye sans diriger, soutient sans enfermer.
Il montre, il questionne, il relance, il donne le cadre, puis s’efface progressivement pour laisser la place à l’autonomie.
Et c’est précisément là que la magie opère : quand l’étudiant prend confiance, ose, se trompe et comprend pourquoi.
L’apprentissage devient alors une aventure partagée.
On le voit dans une salle de classe vivante : les échanges fusent, les idées se croisent, les étudiants se corrigent entre eux — et l’enseignant, au fond, observe avec un léger sourire.
C’est à ce moment-là qu’on se dit : le savoir circule vraiment.
Vers une compétence durable : agir, comprendre, se transformer
Former par compétences, c’est reconnaître que l’apprentissage ne s’achève jamais.
Une compétence ne se possède pas, elle se cultive, s’enrichit et se transforme au fil des expériences.
Ainsi, enseigner, ce n’est pas transmettre un savoir figé,
c’est accompagner un mouvement, aider à comprendre, agir et se dépasser.
Au fond, apprendre une compétence,
c’est apprendre à devenir soi dans l’action —
et c’est sans doute là que commence la véritable réussite.
Et si comprendre la compétence était une première étape, le prochain défi sera de voir comment les pédagogies actives lui donnent vie, chaque jour, dans nos classes.